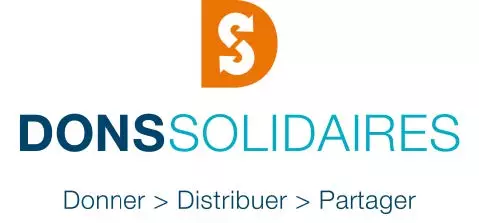L’IFOP et Dons Solidaires publient la nouvelle vague du baromètre sur la précarité hygiénique et menstruelle en France, en voici les principaux enseignements
En ce début d’année 2025, la proportion de Français exprimant un sentiment de vulnérabilité économique se maintient à un niveau inquiétant
Au terme d’un pic enregistré entre fin 2023 et début 2024 marqué par une forte inflation et la baisse du pouvoir d’achat, la part des Français faisant état d’un sentiment de vulnérabilité économique tend à la baisse par rapport à l’année dernière, mais demeure à un niveau élevé. Ainsi, la moitié des Français exprime la crainte de ne pas réussir à finir le mois (49% ; -8 pts vs 2024 et -4 pts vs 2023), deux sur cinq estiment qu’ils pourraient basculer dans la pauvreté (41% ; -5pts vs 2024 et -6 pts vs 2023), et un quart qu’ils pourraient avoir à recourir à des associations pour se procurer des denrées alimentaires (21% ; -5 pts par rapport à 2024 et 2023). Ces évolutions peuvent être expliquées par plusieurs facteurs, notamment un effet de normalisation post-inflation, soit l’adaptation des ménages aux prix élevés (changement des habitudes de consommation, alternatives moins chères). D’autre part, elles peuvent aussi être le fruit d’un effet psychologique : après le pic d’anxiété de 2024, les ménages s’adaptent à la situation, même si elle reste difficile. Attention toutefois : la baisse est faible et les niveaux restent très élevés. C’est plus une stabilisation à un niveau préoccupant qu’une véritable amélioration.
Nouveauté de cette vague du baromètre, une anxiété généralisée est exprimée par les parents quant au futur de leur enfant, et ce, quel que soit leur niveau de revenus (78% se disent que leur enfant auront plus de difficultés qu’eux dans leur vie future). Plus largement, un quart des Français déclare avoir rencontré des difficultés chroniques à faire face à leurs dépenses au cours des douze derniers mois (27%). Sur ce point, l’analyse selon le profil socio-démographique est particulièrement riche, puisqu’il met en lumière une « France à plusieurs vitesses ». Premièrement, des populations particulièrement fragiles, en l’occurrence les catégories modestes ou pauvres (respectivement 40% et 55%) et les familles monoparentales (51%). Deuxièmement, ces difficultés touchent également (même si dans une moindre mesure) les classes moyennes inférieures (22%), les jeunes de 18 à 34 ans et les foyers de célibataires sans enfants. Ainsi, seuls les plus âgés et les plus hauts revenus semblent épargnés. Ces difficultés se répercutent de manière limitée, mais réelle sur les enfants dont les parents sont concernés : 42% déclarent que leur enfant se compare aux autres enfants, 38% qu’il exprime de la frustration et 36% qu’il s’inquiète de la situation financière familiale.
Le contexte inflationniste a une incidence notable sur l’achat de produits d’hygiène : la moitié des Français songe aujourd’hui à réduire ce type de dépenses pour des raisons économiques
En 2025, une large majorité de Français perçoit une forte pression sur leur budget dédié aux produits d’hygiène et d’entretien. Ainsi, 68% déclarent avoir constaté une hausse importante des prix, 58% éprouvent davantage de difficultés à trouver des produits à prix réduits et 53% observent une diminution des promotions en magasin. Face à cette situation, de nombreux consommateurs ont modifié leurs comportements d’achat, en adoptant des stratégies d’adaptation : le stockage de produits lors des promotions (74%), la recherche d’alternatives moins chères (69%) et le changement de marque ou de lieu d’achat (67%) sont les pratiques les plus courantes.
Pour 47%, le contexte économique actuel les incite en effet à limiter ou réduire leur consommation de produits d’hygiène (pour des raisons budgétaires). Constat peu encourageant : il s’agit d’un phénomène non seulement diffus (qui touche près de la moitié de la population âgée de 18 ans ou plus), mais qui progresse par rapport à ce qui pouvait être observé en 2023 (+16 pts en 2024 et +13 pts en 2025). 1 Français sur 5 a même été amené à arbitrer entre des produits de première nécessité (nourriture) et des produits d’hygiène (17% ; -5 pts vs 2024), dont 39% dans les catégories pauvres, et 35% des familles monoparentales. Au final, c’est donc 8 à 9 millions de Français qui doivent faire des arbitrages entre deux produits de première nécessité.
Les renoncements se portent assez logiquement principalement sur les produits cosmétiques : principalement le maquillage (pour 33% des femmes), les produits de coloration pour cheveux (pour 27% des femmes) ou les soins hydratants (24%). Corolaire de ces renoncements, une part non-négligeable de Françaises indiquent devoir par manque d’argent ne pas se maquiller (37% ; -1 pt vs 2024), ne pas se colorer les cheveux (36% ; -4 pts). De même, 38% des répondants déclarent ne pas faire couper leurs cheveux ou ceux de leur enfant pour ce même motif (38% ; -3 pts). Si ces renoncements tendent à la baisse entre janvier 2024 et janvier 2025, ils demeurent à des niveaux élevés (et ne retrouvent pas les niveaux d’avant Covid).
Ces renoncements concernent même les produits d’hygiène (et non pas seulement cosmétiques) pour une frange non négligeable de la population. Le renoncement à l’achat de produits d’hygiène de première nécessité concerne près d’un Français sur 10 : 9% pour le shampoing, 8% pour le dentifrice ou le gel douche, soit près de 5 millions de Français concernés. Une proportion plus conséquente encore contrôle aussi ses habitudes d’hygiène du quotidien par manque d’argent, et notamment une vigilance à l’égard des stocks de produits consommés. Environ 12 millions de Français décident de changer de brosse à dent moins souvent qu’ils le souhaiteraient (24% des répondants), 11 millions contrôlent la consommation de papier toilette (22%) et entre 7 et 8 millions ne se lavent pas les cheveux autant qu’ils le souhaiteraient (15%).
Ces pratiques s’étendent également à la propreté du linge et des vêtements : 32% déclare mettre ses vêtements plus longtemps pour consommer moins de lessive/ faire moins de machines, 21% ne pas utiliser de lessive/ réduire la dose de produits dans la machine. Pour les foyers les plus précaires, l’acquisition des produits d’hygiène s’est même faite au cours des derniers mois par une structure d’aide (7% ; soit une proportion stable depuis février 2023). L’ensemble de ces renoncements concernent d’avantage les répondants aux revenus les plus faibles, mais aussi les familles monoparentales – qui y sont aussi particulièrement exposés.
Conséquence directe de la précarité hygiénique : une baisse de l’estime de soi et un risque accru d’isolement social
Le baromètre met en évidence un lien fort entre précarité et sentiment de perte de dignité :
- Premièrement, cette nouvelle vague de l’enquête appuie l’existence de pressions sociales fortes autour de l’apparence : 37% des interviewés se sont déjà senti mal à l’aise par rapport à leur silhouette ou leur poids et jugées négativement, 24% en ce qui concerne les dents, 24% les cheveux. Plus généralement, 2 Français sur 10 ressentent cette pression en raison d’une mauvaise présentation de soi. Dans le détail, les catégories pauvres ou modestes sont les plus touchées par ce sentiment de malaise. Notamment par rapport à leur silhouette/ leur poids (respectivement 55% et 40 ; contre seulement 7% pour les catégories aisées et 5% les hauts revenus), ou encore leur sentiment de « mauvaise » présentation (34% des catégories pauvres et 24% des catégories modestes, contre 10% des catégories aisées et 8% des hauts revenus).
- Et par conséquent un complexe dans le cas de difficultés à se procurer des produits d’hygiène ou cosmétiques. 47% des interviewés qui ont réduit leur consommation de produits d’hygiène et de cosmétiques déclarent que cela a eu un impact néfaste sur leur confiance en eux/ leur estime d’eux-mêmes – et ce, à même niveau quel que soit le sexe.
De ce complexe découle des comportements de renoncement à des activités sociales et professionnelles : 31% des Français ayant renoncer à acheter des produits d’hygiène ont indiqué qu’en raison du manque de produits d’hygiène, ils ne sont pas sortis de chez eux (+3 pts vs janvier 2024), 28% ne pas être bien dans leur travail (+2 pts) et 23% évité ou ignoré quelqu’un qu’ils connaissaient (+1 pts). En d’autres termes, la précarité hygiénique ne relève pas seulement du manque de confort, mais également d’un cercle vicieux. Les difficultés d’hygiène créent de l’isolement qui aggrave la précarité.
La précarité menstruelle : un phénomène inquiétant, et d’avantage répandu depuis l’après-Covid
En dépit des mesures mises en place par les pouvoirs publics, les femmes réglées concernées par la précarité menstruelle se maintient à un niveau élevé depuis février 2023. En janvier 2025, 16% des femmes réglées en effet ont indiquées ne pas disposer suffisamment de protections hygiéniques pour elles-mêmes ou pour leur fille par manque d’argent (soit le double par rapport à novembre 2020 et janvier 2019). Cela correspond cette année à près de 2,9 millions de femmes réglées en situation de précarité hygiénique. Au même titre que les autres produits d’hygiène, ce manque de protections hygiéniques se traduit par l’utilisation fréquente ou occasionnelle de produits de substitution pour 13% d’entre elles. Plus inquiétant encore : la proportion de femmes réglées utilisant des alternatives (pour elle-même ou leur fille) est en augmentation par rapport à la période pré-covid (+7pts vs novembre 2020 et +6 pts vs janvier 2019). Or, l’absence de protections hygiénique entraîne des conséquences néfastes sur la confiance en soi et le quotidien des femmes. Pour 1 femmes menstruée sur 10 cette situation conduit par exemple à de l’isolement social : 9% déclarent que cela leur arrive de ne pas sortir de chez elles ou de manquer le travail en raison de ce manque (+5 pts vs janvier 2019). Cette situation pour la moitié d’entre elle est source de malaise (51%), mais aussi de stress et d’inquiétude (46%) – voir même de conséquences plus graves comme un frein à la réussite professionnelle (12%) ou des difficultés dans les relations sociales (11%).
En parallèle, les femmes menstruées se tournent également d’avantage vers des protections non-jetables, et en particulier les culottes menstruelles (50% de citations ; +17 pts vs février 2023 !). Ce recours aux protections lavables et réutilisables sont motivées à même niveau par des considérations écologiques (47%), économiques (41%), mais aussi de confort (40%) avec le développement de ce type de produits par un nombre croissant de marques. A contrario, si ces produits sont rentables économiquement sur le long terme, leur coût d’acquisition (encore relativement élevé sur le marché) représente l’un de ses principaux freins : 31% des répondants interrogées n’utilisent pas ce type de produits en raison d’un coût trop élevé (31% ; +10 pts vs novembre 2020). Par ailleurs, une méfiance reste encore ancrée dans les esprits quant à son efficacité et à ses promesses (32%).
Les mères célibataires avec enfants sont particulièrement vulnérables à la précarité hygiénique : 21% utilisent des produits de substitution à la place des protections hygiéniques par manque d’argent. Elles se reportent en revanche moins vers les culottes menstruelles que les autres femmes réglées interrogées (39% ; -14 pts par rapport à l’ensemble) – et ce, principalement en raison d’un manque de confiance (41%), d’un prix trop élevé (38%). Ce profil de femmes semble également moins bien informées sur ce type de protections comme motif de non utilisation des culottes ou coupes menstruelles (32% ; +12 pts par rapport à l’ensemble).
Les parents de jeunes enfants : une population particulièrement touchée par le manque de produits d’hygiène
Confrontés à une augmentation soudaine des dépenses au sein de leur foyer pour subvenir aux besoins du bébé, les parents de jeunes enfants (âgés de moins de 3 ans) représentent une strate de la population particulièrement vulnérable en matière de précarité hygiénique. Près d’un quart d’entre eux ne parvient pas à se procurer les produits hygiéniques nécessaires à l’enfant, comme les couches (23% ; dont 8% « souvent ») et les produits d’hygiène/ de soin (23% ; dont 6% « souvent »).
Une part importante de parents adoptent ainsi de stratégies de « débrouille », comme ne pas changer les couches aussi fréquemment qu’ils le souhaiteraient (24%), d’utiliser une protection « bricolée » (22%) ou faire appel à une association pour s’en procurer gratuitement ou à prix réduit (2%). Ce problème impacte également la vie sociale, puisque 28% réduisent le nombre de sorties pour éviter les fuites à l’extérieur de chez eux. Assez logiquement, les catégories pauvres sont d’avantage concernées : 35% des parents issus des catégories « pauvres » se procurent régulièrement à prix très réduit des couches par une association ou un service d’aide social (+13 pts par rapport à l’ensemble des parents d’un enfant de moins de 3 ans interrogés).
Conclusion : Une légère accalmie, mais une précarité toujours plus marquée qu’avant la crise
Les résultats de cette vague montrent que le plus dur est probablement derrière nous : les indicateurs de vulnérabilité économique et de précarité hygiénique sont en légère amélioration par rapport à l’an dernier. Mais cette accalmie ne doit pas masquer l’essentiel : les niveaux restent très élevés, souvent supérieurs à ceux d’avant la crise du Covid. L’inflation a profondément bouleversé les équilibres budgétaires des ménages, forçant près d’un Français sur deux à réduire sa consommation de produits d’hygiène, et un sur cinq à arbitrer entre nourriture et hygiène. Si la situation semble se stabiliser, c’est davantage par adaptation contrainte que par réelle amélioration des conditions de vie. La précarité hygiénique, loin d’être anecdotique, révèle une fragilisation durable du tissu social. Elle touche désormais non seulement les catégories les plus modestes, mais aussi des publics peu perçus comme vulnérables : jeunes actifs et parents notamment. En toile de fond, cette étude met en lumière un enjeu majeur : le retour à la normale n’effacera pas les effets de l’inflation, qui a laissé une empreinte durable sur les comportements et les inégalités. Pour éviter que ces renoncements ne deviennent structurels, il faudra aller au-delà des réponses d’urgence et repenser l’accès aux produits essentiels comme un levier d’inclusion sociale.